 LE SALON
DU
LIVRE DU
GIENNOIS 2003
LE SALON
DU
LIVRE DU
GIENNOIS 2003
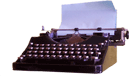
Interview de Didier Daeninckx menée le vendredi 13 décembre 2002 par la classe de troisième technologique du lycée professionnel Paul Langevin de Briare (45) à partir de l’étude de Cannibale.
Thomas : D’où vous est venue l’idée de raconter une histoire sur l’Exposition coloniale ?
Didier Daeninckx : ça fait longtemps que j’y pensais. Dans Cannibale, je parle d’un journal qui s’appelle l’Illustration. C’était un journal publié au XIX°siècle et jusqu’au début des années 1950. Mon grand-père en avait des exemplaires, des paquets énormes, et je les regardais quand j’étais gamin. J’avais vu tout un tas de photos sur l’Exposition Coloniale dans les années cinquante et donc, ça m’avait frappé, cet épisode de l’Exposition Coloniale, mais je ne savais pas ce qui s’était passé. Il y a quelques années, en 1997, je suis allé en Nouvelle-Calédonie et plusieurs Kanaks dans des tribus m’ont raconté cette histoire des Kanaks qui avaient été exposés comme des animaux en 1931. Je ne la connaissais pas, personne en France pratiquement ne connaissait cette histoire et cela m’a choqué que des hommes et des femmes aient pu être exposés comme des animaux il y a seulement soixante-dix ans. Voilà comment l’histoire est née d’un voyage en Nouvelle-Calédonie. Je me suis baladé pendant plusieurs semaines dans presque toutes les tribus Kanaks.
Noémie : Connaissez-vous des personnes qui ont vécu cette histoire ?
D.D. : Des personnes qui ont vécu cette histoire, non je n’en connais pas. C’est des gens qui auraient aujourd’hui au minimum quatre-vingt-dix ans. Donc les personnages de Gocéné et de Badimoin sont vraiment inventés. Je les ai mis dans des histoires un petit peu vraies mais c’est des personnages qui n’ont jamais existé. C’est des personnages de papier. Minoé aussi existe uniquement dans le livre. Il y a eu des femmes qui ont été exposées qui étaient sûrement amoureuses de Kanaks comme ça mais c’est un personnage de roman. Donc la seule personne que j’ai vraiment rencontrée dont les parents ont été exposés au zoo de Vincennes et échangés contre des crocodiles, c’est le joueur de foot Karambeu. J’avais retrouvé tout un tas de photos dont les photos de ses ancêtres, je l’ai donc rencontré et il savait une partie de l’histoire. Mais les gens qui ont été exposés, je pense qu’ils sont tous décédés. En plus, en Europe grâce à la médecine les gens vivent en moyenne soixante-quinze ans, il y a même des centenaires. Dans les tribus Kanaks, c’est assez rare de voir quelqu’un atteindre soixante-dix ans. Le taux de mortalité y est plus élevé qu’en métropole. Les aborigènes ont une espérance de vie qui ne dépasse pas une soixantaine d’années.
Rodolphe : Pourquoi dans votre histoire les Kanaks ne se révoltent-ils pas ?
D.D. : En 1931, il devait y avoir 20000 habitants en Nouvelle-Calédonie dont beaucoup de Caldoches, des descendants d’Européens qui sont venus en Nouvelle-Calédonie ou des gens de l’administration venus pour travailler. Il y a eu des révoltes quand les Français ont colonisé la Nouvelle-Calédonie, à partir de la conquête de l’île en 1853 jusqu’en 1950. Cela fera cent cinquante ans en 2003. Les gens se sont révoltés car ils ne voulaient pas être occupés et il y a eu des centaines de morts. Il y a même eu une révolte très importante, celle d’un chef Kanak qui s’appelait Ataï. Il a failli réussir à mettre les Français à la porte, à les renvoyer chez eux. En 1878 il avait presque gagné la guerre mais il a été trahi et fait prisonnier. L’armée française lui a coupé la tête, l’a mise dans du formol, les yeux ouverts, les cheveux en désordre, et l’a expédiée en France. J’ai écrit aussi un livre à ce sujet : Le retour d’Ataï. Aujourd’hui les Kanaks demandent qu’on leur rende la tête du chef de la révolte de 1878 mais elle est dans un musée français. Des révoltes comme celle-là il y en a eu énormément de la part des Kanaks. A l’époque d’Ataï, il y avait 50000 Kanaks et la France a décidé de les exterminer, comme ont fait les Américains avec les Indiens. En Amérique le massacre a duré de 1850 jusque dans les années 1880. Au moment de la première guerre mondiale, il restait environ 20000 Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Plus de la moitié avaient donc déjà été tués. Sur les 20000 hommes, femmes, vieillards et enfants survivants, 2000 jeunes hommes sont envoyés sur le continent dans les tranchées de la guerre 14-18. Cela représente le dixième de la population Kanake. On est 60 millions de Français, c’est comme si, du jour au lendemain, 6 millions de jeunes garçons partaient pour une guerre. Sur les 2000 appelés, 1000 ont été tués, c’est considérable. Ce qui fait que lorsque des gens sont envoyés en France pour l’Exposition Coloniale, le peuple kanak a déjà subi des coups très durs. Il a perdu les trois-quarts de ses forces du fait de la répression et de la guerre de 14-18. Il faut dire que la disproportion était énorme. Ce tout petit territoire de Nouvelle-Calédonie habité par des Kanaks armés uniquement d’arcs et de flèches et qui vivent de la pêche a été vaincu par la puissance de la France, colonisé par des dizaines de millions de personnes. La deuxième raison c’est que c’est les chefs des tribus qui ont dit : « toi tu iras, toi tu iras. » Les chefs de tribus après la guerre, ils travaillaient main dans la main avec les colonisateurs, avec les Français. Ils rendaient un peu service, donc ils étaient tolérés. Et c’est les chefs qui ont désigné ceux qui devaient aller en France. Donc c’est la parole du chef qui les a envoyés. La France a demandé aux chefs des tribus de lui donner des hommes. Et donc, les hommes qui se sont retrouvés à Paris pouvaient se révolter contre le sort qui leur était fait de se retrouver exposés dans un zoo mais pour cela il fallait qu’ils se révoltent contre l’autorité du chef. C’était donc très compliqué pour eux et ça explique qu’il n’y a pas eu de révolte.
Dany : Combien de temps avez-vous mis pour écrire ce livre ?
D.D. : J’ai écrit assez rapidement. Je l’ai écrit en deux parties. D’abord en 1998, un an après être revenu de Nouvelle-Calédonie. C’était les 150 ans de l’abolition de l’esclavage. Dans les textes, l’esclavage a été aboli en 1848 et donc en 1998 une radio qui s’appelle France Culture m’a demandé d’écrire une pièce de théâtre pour la radio, une pièce radiophonique sur l’abolition de l’esclavage. Comme j’étais au courant de cette histoire de Kanaks, je me suis dit : « L’esclavage a été aboli, dans les textes mais est-ce qu’il n’existe pas encore dans la vie de tous les jours ? » C’est bien beau de faire un texte disant que l’esclavage est aboli si on continue à mettre des gens en esclavage le texte ne vaut pas grand chose. Donc j’ai dit aux gens de France Culture que j’avais choisi de raconter l’histoire des Kanaks pour montrer que l’abolition a été décidée mais qu’il y a des pratiques qui ne sont pas plus jolies que l’esclavage. J’ai donc écrit cette pièce de théâtre qui s’appelle Des Kanaks à Paris en trois semaines. Quand la pièce est passée sur les ondes de la radio, j’ai eu envie d’en faire un roman. J’ai retravaillé trois semaines pour faire un roman assez court, à peine une centaine de pages. J’ai écrit le tout en un mois et demi.
la professeur de français: ça te laisse rêveur Douglas… Nous aussi. (rires)
D.D. : C’est un petit livre, minuscule (joignant le geste à la parole).
la professeur de français: : Ne leur dites pas ça, c’est un livre considérable ! (pour certains élèves c’est le seul qu’ils sont parvenu à lire en entier)
D.D. : Et puis c’est assez facile d’écrire. Vous avez les outils sur la table : un stylo et du papier et avec l’alphabet a, b, c , d, ainsi de suite vous n’avez besoin de rien de plus…
Douglas : … des idées …
D.D. : … des idées ! Mais tout le monde en a. Tout le monde a une tête et tout le monde a des histoires dans la tête. Moi, je suis arrivé ici et la première chose que j’ai vue c’est un écriteau marqué : Pont canal. Et il y a un mois j’écrivais une nouvelle qui fait une cinquantaine de pages sur l’univers du cirque. J’ai mis le cirque qui arrive dans le Sud-Ouest de la France devant un pont canal qui est à côté d’Agen. Le cirque est là avec ses camions, les animaux et tout et il y a un rideau d’arbres avec des peupliers, des feuilles qui cachent ce qu’il y a derrière. Et d’un seul coup, ils sont un peu en hauteur comme ça et au-dessus des arbres il y a un bateau qui passe. Ils s’arrêtent tous et ils sont émerveillés de voir un voilier, un grand voilier qui passe dans les airs, comme ça.(gestes). Et, en fin de compte, ils remontent dans les camions, ils passent le rideau d’arbres et, à ce moment, ils voient le pont canal, il est vraiment très long à côté d’Agen, et ils s’aperçoivent que le voilier passait au-dessus de la vallée grâce au pont. Donc quand je suis arrivé à Briare, je suis allé voir le pont canal. Je sais pas… mais il y a sans doute des histoires à écrire. Quand il y a des paysages comme celui-là, ça dit des choses.
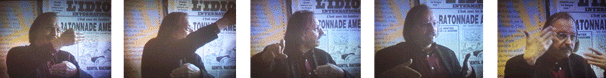
Douglas : Oui mais c’est pas facile aussi…
D.D. : On peut inventer des choses, quand il y a des bateaux (geste de vagues), il y a de l’imaginaire. On se demande ce qu’il y a sur les bateaux, où ils vont, la flibuste, l’île au trésor, ça va vite. (rires)
Jeremy : Comment saviez-vous que Willie Karembeu, l’arrière-grand-père du footballeur, faisait partie des Kanaks exposés à Paris ?
D.D. : Je ne le savais pas. Quand j’ai écrit Cannibale, j’avais tout un tas de documentation. J’écrivais ça deux mois avant la coupe de monde de foot en avril-mai 98. Et ça arrêtait pas de parler de la coupe du monde qui allait avoir lieu à Saint-Denis. En plus, Saint-Denis, c’est ma ville natale, j’y suis né et j’habite à côté. J’écrivais et dans ma tête je me disais : « C’est bizarre, je suis en train d’écrire ce livre et j’ai l’impression qu’on m’a parlé de Karambeu. » Bon, je finis le bouquin, je le donne à mon éditeur, et l’éditeur quand vous avez donné votre disquette avec tout le roman tapé dessus, il la donne à un correcteur qui relit le texte pour voir s’il n’y a pas de fautes, s’il n’y a pas des mots qui ne veulent rien dire, si une phrase n’est pas bancale… Le correcteur corrige au crayon noir et ensuite il le retourne. Ce texte que vous avez écrit, une fois qu’il a été corrigé par un professionnel, s’appelle les épreuves. Il faut les relire et les signer pour dire qu’on accepte que le livre soit imprimé avec les corrections. Et, à ce moment-là, j’ai les épreuves en main et je me dis : « Purée, il y a cette histoire de Karambeu là-dedans. » Je reprends alors toute ma documentation et derrière une photo il y a le nom des Kanaks qui avaient été échangés contre les crocodiles allemands. Il y en avait un qui s’appelait Willie Karambeu ! Je me suis donc mis en contact grâce à une copine journaliste avec Christian Karambeu qui était au Real de Madrid, c’est le truc où il y a Zidane aujourd’hui. En 98 Karambeu y jouait et je lui ai envoyé une lettre avec le texte de mon bouquin en disant : « Il y a quelqu’un qui porte le même nom que vous qui a été exposé comme un animal en 1931. » Il nous a répondu au mois de septembre, après la coupe du monde et je suis allé passer une journée à Clairefontaine, au truc d’entraînement de l’équipe de France. Et je me souviens, c’était le jour où ils recevaient leurs maillots avec l’étoile dorée là (geste sur la poitrine). Quelqu’un est venu leur apporter et ils l’ont tous essayé, il y avait Zidane, il y avait toute la troupe. Anelka était là aussi dans les jeunes qui s’entraînaient. J’ai montré la photo à Karambeu et il a tout de suite mis le doigt sur son arrière-grand-père. A l’époque cela faisait soixante sept ans que ça avait eu lieu et il n’en avait jamais parlé à personne de cette histoire là. Il a expliqué que toute sa famille avait honte de ce qui était arrivé à l’arrière-grand-père maternel et paternel, les deux avaient été échangés. Et il a dit : « Mais c’est pas nous qui devrions avoir honte, c’est les gens qui les ont exposés qui devraient avoir honte. » Et c’est pourquoi il a accepté de parler en disant : « j’enlève la honte de mes épaules (geste) et je la mets sur ceux qui sont responsables… »
Douglas (Brésilien arrivé en France depuis peu): Et il a enlevé le T-shirt de la honte ?
D.D. : (rires) non, non, la honte, le T-shirt il l’a toujours mais ils n’ont pas réussi à ajouter d’étoile.
Mickaël : Comment faites-vous pour rendre vos personnages crédibles ?
D.D. : Rendre les personnages crédibles, c’est le principal boulot du romancier, c’est arriver à comprendre comment fonctionne le personnage. Par exemple pour Gocéné, il fallait que je me mette dans la peau d’un personnage Kanak qui se retrouve en 1985 sur des barrages avec des jeunes et qui a environ 70, 75 ans. C’est très compliqué à faire. J’ai d’abord lu plein de choses sur le monde kanak, des contes et légendes. Chez les Kanaks la transmission de la culture ne se fait pas par les livres, elle se fait par la parole, comme le font les griots africains. Maintenant, il commence à y avoir des gens dans les tribus qui écrivent mais c’est très récent, cela fait seulement quinze ou vingt ans. Donc, pratiquement toute la culture est dans la tête des gens. Ce qui fait qu’il y a des scientifiques, des ethnologues qui sont allés en Nouvelle-Calédonie pour y enregistrer les Kanaks. Ils ont enregistré ce que les gens avaient dans la tête et ils l’ont mis dans des livres. Quand vous lisez ces livres, c’est des gens qui prennent la parole. Et grâce à la parole de ces Kanaks retranscrite dans ces livres, vous vous accaparez une partie de la mentalité, de la culture, des références. Donc j’ai travaillé de cette manière et ce qui m’a beaucoup facilité la tâche, c’est que dans Cannibale, c’est Gocéné qui parle. Je n’aurais pas réussi à écrire ce livre si je n’avais pas décidé que c’est Gocéné qui prendrait la parole. Dans tout le livre vous avez Gocéné qui parle comme il parlerait à ses enfants, comme un griot africain qui raconte une histoire. Et ça, ça m’a grandement facilité le travail. C’est pratiquement comme quand on était gamin : Gocéné est là et il dit : « Il était une fois le pays kanak… »
Douglas : C’est comme ça que vous avez connu l’histoire de la grotte ?
D.D. : Ah ! Non, l’histoire de la grotte je la connaissais bien avant. Cannibale se passe en 1985 et cet épisode n’a pas encore eu lieu. Ca arrive juste après la fin du livre. A la dernière page on comprend qu’ils vont se battre, qu’il va y avoir un malheur.
L’histoire de la grotte d’Ouvéa je l’ai apprise quand ça s’est passé. C’est quelque chose qui m’avait heurté fortement. C’est l’histoire de jeunes indépendantistes kanaks qui ont tué un gendarme et qui sont pourchassés. Ils prennent alors des gendarmes en otages et les emmènent dans une grotte sur une toute petite île, Ouvéa, qui est juste à côté de celle de Karambeu. C’est pratiquement un lagon. Il n’y a pas beaucoup de terre mais il y a des grottes de corail.
Douglas : Moi, je pensais à la grotte dans le roman. Quand il pleut et que Badimoin veut pas descendre dans le métro.
D.D. : Ah ! Non, ça c’est une histoire que j’ai inventée parce que pour les Kanaks le sous-sol représente l’enfer. Dans le livre ils hésitent à descendre dans le métro essentiellement pour des raisons religieuses. Pour eux, le paradis est aérien et l’enfer est souterrain. Ils n’enterrent pas leurs morts. Les morts sont mis en hauteur sur les arbres. Il y a un rapport à la grotte qui est très difficile pour eux.
La fin de l’histoire d’Ouvéa, c’est que les gendarmes et l’armée française ont attaqué. Ils avaient ce que l’on voit maintenant avec les préparatifs de la guerre en Irak, les lunettes infrarouges. Ils sont arrivés dans une grotte qui était complètement plongée dans l’obscurité sauf qu’eux ils voyaient comme en plein jour grâce à leur équipement. Et ils ont tué tous les Kanaks. Il y en avait dix-neuf et on sait aujourd’hui que certains d’entre eux n’étaient que blessés et ont été achevés par la gendarmerie. Il y a eu un dérapage de la part des jeunes kanaks qui ont assassiné et pris en otages les gendarmes, et puis, en réponse, il y a eu un gros dérapage aussi de la part de la gendarmerie qui a tué, achevé et aussi torturé les survivants.
Zelda : A quel âge avez-vous commencé à écrire ?
D.D. : A six ans (rires) vous aussi ?
Zelda (précise sa question) :…A devenir écrivain…
D.D. : C’est ce que je disais tout à l’heure. Dès l’instant où l’on a l’alphabet, un stylo et du papier, on peut écrire. Après, est-ce que c’est bien est-ce que c’est mal, on en juge. Mais dès l’instant où vous êtes allé à l’école, et c’est obligatoire, vous avez appris à lire et à écrire et un petit peu à penser. Normalement chacun devrait pouvoir arriver à bâtir des histoires.
Moi je suis devenu écrivain par hasard à vingt-sept ans. J’ai écrit mon premier roman à vingt-sept, vingt-huit ans, en 1977. Par hasard parce que je travaillais et je suis tombé au chômage. Je suis resté au chômage pendant très très longtemps et donc, pour occuper les journées qui sont très longues - quand on a pas de travail, on a l’impression que c’est des siècles – j’ai écrit un premier livre. Donc je suis devenu écrivain parce que dans mon métier il n’y avait plus de boulot.
Thomas : L’écriture est-elle toujours un plaisir ?
D.D. : C’est très compliqué. C’est comme quelqu’un qui fait de la musique et qui va faire des gammes au piano pendant des heures chaque jour et pendant des années. Et puis à un moment il arrive à jouer une sonate de manière parfaite. Il y a un bonheur absolument immense. Quelqu’un qui fait du sport, qui va s’entraîner pendant des années parce qu’il veut courir le marathon de New York – j’en connais qui font ça – c’est dur, on s’arrache les poumons et puis arrive le moment où on court le marathon et il y a un bonheur immense. L’écriture c’est la même chose. Pour moi, c’est vraiment extraordinaire ! C’est quelque chose dont je ne pourrais pas me passer mais ça demande beaucoup d’efforts le fait de rester devant un ordinateur ou une feuille pendant des heures pour essayer de bâtir une histoire que personne ne vous a demandé d’écrire. Il faut se forcer. Il y a plein d’autres choses plus simples, enfin, qui paraissent plus sympas mais c’est un plaisir. Moi quand j’ai terminé, c’est extraordinaire. Je suis vraiment heureux comme c’est pas permis. Mais c’est du boulot. J’ai commencé une nouvelle il y a deux jours. C’est une petite nouvelle, elle va faire quinze pages (rires). J’en ai écrit quatre pages avant-hier, quatre pages hier et ce matin, avant de partir, pendant une demi-heure, trois-quarts d’heure, un peu plus d’une demi-page. J’étais content d’avoir pu écrire un petit morceau avant de partir.
Douglas : Mais une nouvelle ça se suit pas…
D.D. : Mais si, il y a un début, un milieu et une fin mais c’est très court. C’est comme un roman qui ferait dix pages.
Douglas : Pas plus ?
D.D. : Il y a des sujets qui ne tiennent pas quinze pages. Au bout de trois, quatre pages c’est fini, il n’y a plus rien à dire ou sinon vous avez l’impression de rallonger la sauce. D’autres sujets demandent deux cents pages. Les plus courtes des nouvelles que j’ai écrites font une demi-page, les plus longues font une centaine de pages.
François : Quel est votre rêve d’écrivain ?
D.D. : Il n’y a pas de diplôme d’écrivain. On le devient quand on écrit des livres qui sont publiés et qui sont lus. Il y a donc quelque chose d’immatériel, de bizarre, au fait de devenir écrivain. Le rêve c’est de continuer et d’avoir toujours des idées et assez de forces pour écrire. Je vois plein de copains écrivains qui ont écrit un bouquin, deux bouquins, trois bouquins, et le quatrième personne n’en veut. Ils n’arrivent plus à publier et ils sont dans un état de désespoir vraiment très fort.
(Sonnerie de portable) Louis : Oups, c’est ma mère !
D.D. : J’ai écrit des nouvelles sur les portables, des textes de dix à quinze pages sur comment on devient meurtrier parce qu’on a hérité d’un portable. Tout le début de mon dernier roman (12, rue Meckert) c’est sur un journaliste qui est le dernier de France à ne pas avoir de téléphone portable. C’est intéressant en tant que romancier de travailler sur tous les objets qui naissent. L’autre fois, on était avec un écrivain, un zozo complet, il avait une grosse bagnole et il roulait à cent cinquante, cent soixante. On allait dans un tout petit endroit d’Alsace, complètement paumé. Il ne savait pas où c’était mais il fonçait parce qu’il avait le truc… ça s’appelle comment ?
Le chœur des élèves : le GPS !
La professeur de français : Le quoi ?
D.D. : Le GPS c’est un ordinateur de bord. Donc, il conduisait à fond la caisse comme si l’ordinateur lui servait d’armure. Il avait programmé son truc et c’est comme s’il était déjà arrivé.
Et à un moment, on a tourné trois fois autour d’un rond point. Il venait juste d’être terminé et le GPS ne reconnaissait pas la route ! (rires) Et après on se retrouve sur une autoroute et au dernier moment son GPS lui dit : « La sortie c’est celle-là. » Il flottait, il y avait une espèce de grésil, on était à cent cinquante. Il pile et il prend la sortie ! Donc, ça peut faciliter la vie mais ça peut assez vite vous l’ôter. Dans cinq, six ans, tout le monde saura s’en servir du GPS et il n’y aura plus de problème. Mais là, quand ça arrive, personne ne sait se servir de ces objets et alors, c’est l’objet qui vous commande. Pareil pour les ordinateurs, pendant des années c’est eux qui dirigeaient. Il y avait des pannes, des disparitions de fichiers et maintenant, c’est à peu près au point. Il faut toujours un temps pour que l’homme arrive à domestiquer ce genre d’outils. Et pour l’instant c’est le GPS qui commande dans la bagnole. Alors il faut faire gaffe si on vous fait monter dans une voiture équipée du GPS…(rires)
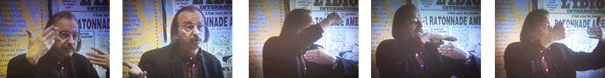
Angélique : Qu’est-ce que vous aimez dans ce métier ?
D.D. : Avant d’être écrivain, j’ai travaillé dans des ateliers d’imprimerie. Tout un tas de boulots comme ça où, au-dessus de moi il y avait toujours un contremaître, dans tous les métiers que j’ai faits. Il y en a qui m ‘ont vraiment intéressé mais il y avait toujours quelqu’un pour me dire comment faire. Et, quand j’avais des idées, on me disait : « non, tu fais ça comme ça ! » Le monde du travail est organisé de telle manière qu’il y en a qui commandent et d’autres qui obéissent. Dans le métier d’écrivain, quand on a un peu de succès, on fait vraiment ce qu’on a envie de faire. Je vous racontais que j’avais envie d’écrire une petite nouvelle sur le cirque. Eh bien, j’ai pris quinze jours. J’ai lu des bouquins sur le cirque. Je me suis renseigné sur les numéros, sur les animaux savants… Puis j’ai écrit mon histoire. Ce qui me plait vraiment c’est la liberté. La liberté d’organiser son temps et de penser à ce qu’on a envie. Il n’y a pas beaucoup de métiers comme ça, c’est un luxe énorme.
Zelda : Comment vous vient l’inspiration ?
D.D. : L’inspiration, je n’en ai jamais eue. Je ne crois pas à ce mot. Que ce soit pour les écrivains, les chanteurs, les musiciens, les chorégraphes, les peintres, enfin dans tous les domaines artistiques il y a une sensibilité particulière, quelque chose qui passe. Il y a des gens qui arrivent à exprimer des sentiments au moyen de notes de musique ou de couleurs. Des gens qui ont cette capacité à toucher les autres avec ce qu’ils ont dans la tête, avec leurs idées, avec leurs passions. Mais je n’ai pas l’impression que c’est quelque chose qui vient d’ailleurs d’eux-mêmes. Avec le terme d’inspiration, on a l’impression que l’écrivain s’assoit à sa table, qu’il prend son stylo magique et que, d’un seul coup, il y a un fluide qui rentre là (il montre le capuchon du stylo) et (bruit d’écriture frénétique) il y a l’inspiration qui est là ! Non, je ne sais plus quel écrivain disait : « L’écriture c’est 99% de transpiration et 1% d’inspiration. » Vous voyez, il y a du travail. Ce travail ça peut-être seulement bouquiner. Là je veux écrire un roman sur les tziganes, les romanichels. Je vais écrire ça dans les semaines qui viennent. Cette semaine j’ai regardé des films. Il y a un réalisateur si vous n’avez jamais vu ses films, je suis sûr qu’ils vous intéresseraient. Il s’appelle Tony Gatlif, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui le connaissent, c’est un gitan, sa mère était romanichelle et son père algérien. Il a fait plusieurs films en France qui sont extraordinaires. J’en ai vu un qui s’appelle Les Princes avec Gérard Darmon qui joue le rôle d’un gitan. Je suis aussi en train de regarder les films d’un réalisateur yougoslave, Emir Kusturica, qui a fait par exemple Papa est en voyage d’affaires, ce sont des films absolument étonnants. Donc mon inspiration c’est de regarder ces films là pour être dans la musique tzigane, pour être dans la manière de vivre, pour voir quelle place ont les femmes, quelle place ont les hommes, quelle place ont les enfants. ça me donne plein d’idées. Je ne vais pas copier ce que je vois mais « ça me fait tourner la tête » comme disait la chanson et après je n’écris plus de la même manière. Je lis aussi des livres historiques sur les tziganes et il y a un travail d’imprégnation qui se fait comme ça. Ensuite, vous inventez des personnages avec ce que vous avez dans la tête.
Douglas : Combien de temps durent les recherches ?
D.D. : Je vais faire des recherches pendant quinze jours, trois semaines mais sur les gitans j’ai déjà plein de choses en tête d’il y a quinze ou trente ans. Un écrivain travaille à partir de ce qu’il a vécu depuis sa naissance, à partir des paysages, des réflexions, des visages… Après, il y a une idée qui vient et cela vous demande d’être un peu plus en phase avec tel ou tel problème et vous recueillez de la documentation un peu plus ciblée mais c’est tout le reste de votre vie qui vous aide.
Elisabeth : Vous avez écrit combien de livres ?
D.D. : Depuis vingt ans, j’ai écrit une quarantaine de livres ; ça en fait deux par an. C’est pas énorme. (rires) Dedans, il y a des romans, il y a des recueils de nouvelles, j’ai écrit des scénarios de BD, des livres pour enfants, des livres avec des photographes – j’aime bien travailler avec des photographes.
Cédric : Quel est le livre que vous avez préféré écrire ?
D.D. : Il y a deux livres où je me suis amusé en les écrivant, c’était des livres un peu pamphlets, c’est-à-dire des livres où on décide de filer des coups de poing et des coups de pieds avec des lignes à des gens qu’on aime pas. C’est un texte où on attaque assez durement. Il y a une série d’aventures d’un personnage qui s’appelle le Poulpe et on m’a demandé d’en écrire deux : Nazis dans le métro et le deuxième : Ethique en toc sur les profs de l’université lyonnaise. Ces deux romans, je les ai écrits en jubilant. C’est comme si on vous filait des penalties et que vous marquiez à chaque fois.
Lydia : Est-ce qu’il y a un de vos livres que vous n’aimez pas ?
D.D. : Oui, il y en avait un : Mort au premier tour. ça se passe en Alsace et quand je l’ai écrit, en 1977 j’étais chez un de mes oncles à La Rochelle qui m’avait accueilli alors que j’étais au chômage. Je ne connaissais pas l’Alsace, je ne savais pas à quoi ça ressemblait, donc, dans ce bouquin, j’ai écrit n’importe quoi. (rires) Et il y a eu un malheur car après la publication de ce bouquin j’ai repris le personnage, l’inspecteur Cadin, et le reste de ses aventures a eu du succès. Les gens me disaient : « Mais le premier livre où il y a l’inspecteur Cadin, en Alsace, vous allez le republier ? » Et je ne voulais pas tellement il était mauvais. Et vingt ans après, en 1997, je l’ai complètement réécrit. Maintenant c’est un livre normal mais avant il était complètement mal foutu. La première fois que vous écrivez, vous ne savez pas comment construire le roman, les dialogues, les chapitres… Je ne savais pas, j’avais lu beaucoup de bouquins, mais je ne savais pas en écrire. Donc, la première version de Mort au premier tour je ne l’aime pas beaucoup, le reste ça va.
Alexandre : Ecrivez-vous toujours le même genre de livres ?
D.D. : Non pas vraiment. Il y a un thème qui revient fréquemment dans mes livres c’est le thème du passé, de la mémoire. Mes personnages ont souvent besoin de s’appuyer sur ce qui s’est passé auparavant, sur leurs parents ou grands-parents pour pouvoir continuer à vivre. Par exemple dans Cannibale vous avez ça. Vous avez des jeunes Kanaks qui sont sympas. Ils sont sur leur barrage à essayer de réclamer l’indépendance pour leur pays. Ils ont pris les armes et ils font quelque chose d’absolument effroyable dès le départ. Une camionnette arrive. Dedans il y a un vieux Kanak et un vieil Européen et parce qu’ils ne supportent plus que la France gouverne leur pays, parce qu’ils ne supportent plus d’être dépendants de la France et parce qu’ils ne supportent plus le racisme des blancs vis-à-vis des Kanaks, ils virent le blanc. Ils disent au Kanak de descendre et à Caroz : « Toi tu t’en vas ! » C’est un acte profondément raciste. Tout Cannibale peut être résumé ainsi : c’est Gocéné qui dit à ces jeunes : « Vous voulez être indépendants. Vous voulez que votre pays, on y vive bien… et qu’est-ce que vous faites ? Vous faites pareil que les autres. Les autres, uniquement parce qu’ils voient votre couleur de peau, ils vous méprisent. Et vous, uniquement parce qu’il est blanc, vous l’avez jeté ! Ce qui est important chez un homme, c’est ce qu’il a dans la tête ! Moi, je vais vous raconter ce que j’ai dans la tête… » Et alors, il leur raconte l’Exposition coloniale, la guerre de 14-18, les Kanaks… et il dit aux jeunes : « Vous vous êtes comportés de cette manière parce que vous n’avez rien dans la tête. Il vous manque des choses. Il faut se remplir la tête et ensuite on a de quoi juger et on ne fait pas cette saloperie que vous avez faite au départ vis-à-vis de mon pote. »
Le thème du passé, on peut le traiter de dix mille façons différentes. C’est le thème qui est dans pratiquement tous mes livres mais, à un moment j’écris sur les Kanaks, à un autre moment l’histoire se passe à Strasbourg avec des Alsaciens, là, j’ai écrit un texte sur le cirque avec des dresseurs de tigres et un type qui roule sur un vélo avec une petite roue et ainsi de suite… le thème est toujours le même mais les univers sont très différents.
Cédric ? Est-ce vous qui choisissez les titres de vos romans et les premières de couverture ?
D.D. : Les titres, je les ai toujours choisis. Parfois, l’éditeur n’était pas toujours d’accord mais je me suis battu pour conserver mon titre. Je n’ai pas le souvenir d’un titre qu’on m’ait demandé de changer…
La compagne de Didier Daeninckx : Si: 12, rue Meckert.
D.D. : Ah ! 12, rue Meckert, oui mais c’est moi qui ai trouvé le deuxième. J’avais écrit un bouquin qui s’appelait J’accuse : en référence à un grand écrivain qui a écrit un article qui s’appelait J’accuse à la fin du XIX° siècle quand on avait accusé le capitaine Dreyfus d’avoir trahi la France. En fin de compte, c’était un acte raciste, une accusation mensongère : parce que cet officier était juif, on pensait que c’était lui qui avait trahi. On s’est aperçu après que c’était une machination et qu’il n’avait pas trahi, bien au contraire et Dreyfus a été réhabilité. Il a été réhabilité grâce à un écrivain : Emile Zola qui avait publié un article dans un journal qui n’existe plus, l’Aurore et dont le titre était donc J’accuse. « J’accuse la France d’avoir fomenté un complot. J’accuse un tel d’avoir fait ceci… » Cet article a eu un retentissement considérable et j’ai donc voulu écrire un bouquin, l’histoire d’un journal, qui s’appelle ainsi. Puis mon éditeur m’a dit : « Attention, ce titre appartient à Zola. C’est un peu gonflé de le reprendre. Il faudrait avoir l’autorisation de sa famille ou de ses descendants. » J’ai écrit. Je n’ai jamais eu de réponses : par prudence, j’ai choisi un autre titre.
La professeur de français: et pour les couvertures ?
D.D. : Pour les couvertures c’est plus compliqué. Deux ou trois fois les couvertures m’ont déplu, je suis intervenu et depuis on me demande mon avis. Par exemple pour l’édition de Cannibale dans la collection Folio, ils m’ont mis une photo de Kanak qui ne date pas de 1931. alors qu’il y a plein de photos de Kanaks de cette époque qu’ils auraient pu mettre comme Magnard qui a bien fait le boulot. Et là, ils m’ont mis quelque chose qui date de 1889, 1890. C’était le prince Napoléon, un descendant de Napoléon III, qui allait dans toutes les expos à travers le monde et photographiait les Indiens, les Lapons les Kanaks…Il a photographié ce qu’on appelait à l’époque les races humaines ; maintenant on sait qu’il n’y a qu’une seule race. Il a fait des dizaines de millier de photographies ce Prince Napoléon et Gallimard est allé choisir dans cette collection. C’est un regard que je n’aime pas. Il photographiait ça comme s’il photographiait un truc folklorique, exotique. ça ne me plait pas ce regard. Il y a d’autres photos beaucoup plus fortes qui auraient mieux convenu. Ils ne m’ont pas prévenu sinon je leur aurais proposé autre chose.
Douglas : Quel est le pourcentage du prix du livre qui vous revient ?
D.D. : ça dépend des livres. Quand c’est un bouquin à cent francs – la première édition du livre -, l’écrivain a 10%. ça fait dix francs par exemplaire. Pour Magnard, l’écrivain à 7% du prix de vente. C’est des livres à 30 francs, l’écrivain touche 2 francs et pour les folio à 20 francs, l’écrivain perçoit 5%, soit 1 franc. En gros en édition de poche c’est 5% et en édition brochée, l’édition courante, c’est 10%.
Mais ça dépend des pays. Les pays nordiques par exemple ont une politique de droits d’auteur différente. Les droits d’auteur c’est comme ça qu’on appelle ce que gagne un écrivain, c’est ses droits en tant qu’auteur. Donc, les pays nordiques ont des populations extrêmement faibles, à peine quelques millions d’habitants et leurs langues ne sont pas parlées ailleurs. Ce qui fait que si leurs écrivains étaient payés comme en France, tous les écrivains de Finlande ou de Norvège crèveraient la faim puisqu’il n’y a pas assez de population pour pouvoir vendre beaucoup de livres. Ils perçoivent donc jusqu’à 30% du prix de vente, c’est beaucoup. C’est des pays qui ont pris conscience qu’il fallait augmenter le droit d’auteur pour qu’il y ait encore des écrivains qui survivent. Sinon, il n’y aurait plus que des livres traduits de l’anglais. Ils ont donc réussi à préserver leur culture littéraire grâce à cela. En France, on est un petit peu à la traîne. Il y a beaucoup d’écrivains que je connais qui font des livres absolument remarquables mais qui ne vendent pas assez pour arrêter de travailler à côté. Ils sont donc obligés d’avoir un métier et d’écrire sur leur temps libre. Il y en a beaucoup qui attendent la retraite pour être tranquilles et c’est dommageable. Quand vous voyez quelqu’un qui écrit des choses importantes, ce serait bien qu’il puisse écrire quand il a trente ou quarante ans et qu’il ne remette pas son écriture après la retraite. A soixante balais, on n’écrit plus la même chose.
Louis : Vous êtes un écrivain engagé, pensez-vous réussir à faire entendre vos idées ?
D.D. : Oui et c’est assez curieux parce que sur un certain nombre de sujets j’ai des idées très minoritaires. Mais par l’écriture, il y a une partie de mes convictions qui réussit à passer. Je n’écris pas des livres pour dire : « Pensez comme moi ! » D’abord, dans Cannibale, est-ce que je pense comme Gocéné, est-ce que je pense comme Caroz, est-ce que je pense comme le jeune Wathiock ? Il y a des points de vue différents dans chaque livre. Le deuxième roman que j’ai écrit, Meurtres pour mémoire, parle de la guerre d’Algérie et de deux à trois cents Algériens qui ont été tués dans les rues de Paris par la police de Maurice Papon et jetés à la Seine, il y a quarante ans. Ca a été une nuit d’horreur, dans les livres d’histoire vous avez appris la Saint-Barthélemy. Et bien il y a eu une Saint-Barthélemy il y a seulement quarante ans dans les rues de Paris et elle n’est pratiquement pas mentionnée dans les livres d’histoire. J’avais écrit un livre là-dessus et les historiens considèrent aujourd’hui que c’est grâce à ce livre policier, publié dans la Série noire, que cet événement est revenu dans la mémoire. Une Série Noire, un livre policier a eu la vertu de faire remonter le 17 octobre 1961. C’est comme si cette date-là n’existait plus dans les calendriers et elle est revenue grâce à un roman policier.
La volonté que j’ai, c’est pas de convaincre les gens, c’est pas de dire : « Mes lecteurs, je vais me les mettre dans la poche ! » C’est pas du tout ça. Je l’écris parce que ça m’écœure tellement que ça ne soit pas dit qu’il faut que je l’écrive. Par exemple, actuellement en France, on est sous un matraquage avec l’insécurité dans les cités et je suis très minoritaire sur ce que je pense de l’insécurité. Pour moi, l’une des pires insécurités concerne des gens de votre âge. Il y a huit mille morts par an sur les routes et environ entre mille et mille deux cents meurtres c’est beaucoup. Mais, en France, il y a quinze mille suicides par an dont beaucoup sont des jeunes. C’est douze fois plus que les meurtres et on n’en parle pratiquement jamais à la télévision. Alors, je suis d’accord pour qu’on parle des crimes et des assassinats, pour qu’on dise qu’il faut choper les meurtriers, les juger et puis les punir, pas de problème. Mais il y a plein d’autres aspects de la société dont on ne parle pas, donc dans mes bouquins je mets l’accent dessus. Je suis minoritaire mais je continue. C’est comme pour cette histoire de Kanaks exposés dans des zoos, personne n’en parlait. C’était complètement oublié. Pourtant il y avait des scientifiques qui travaillaient sur ce sujet mais quand ils voulaient publier des livres on leur répondait : « ça n’intéresse personne, on va en vendre deux cents ! » Eux, ils ne pouvaient pas publier et moi j’ai eu la chance de tomber sur l’histoire de Karambeu, ce qui fait que les journaux ont fait des articles, que Karambeu est passé chez Ardisson et qu’on en a parlé. C’est ce hasard-là qui fait que maintenant pratiquement tout le monde est au courant de ce qui s’est passé en 1931. Il y a seulement cinq ans, personne n’était au courant, même en Nouvelle-Calédonie presque tout le monde avait oublié ça. Le livre a encore cette capacité à alerter ou à mettre en colère. J’écris parce que ça me met en colère. Alors après, qu’il y ait des gens qui le lisent et qui disent : « Purée, c’est incroyable, on en était encore là il y a seulement soixante-dix ans ! » Si ça fait marcher un petit peu les têtes, tant mieux.
Thomas : Quel effet ça vous fait que vos livres soient étudiés à l’école ?
D.D. : Je n’ai pas fait d’études, j’ai arrêté en fin de seconde. Et aujourd’hui mes livres sont étudiés à l’école. Il y a Cannibale, la Mort n’oublie personne, il y a des nouvelles dans des bouquins de sixième, dans les bouquins de terminale tout un texte, La Repentie, est publié. Et pourtant je n’ai pas l’impression que mes livres entrent naturellement à l’école. Par exemple, Cannibale, c’est un texte qui est difficile à aborder. On peut avoir l’impression que l’école préfère les textes qui sont plus tranquilles, qui ne posent pas de problèmes et pourtant Cannibale est étudié dans des centaines de clases et ça suscite des débats. La France est un pays où le racisme est très important, où le regret de l’Empire colonial est très présent. Il y a plein de gens qui préféreraient que la France ait gardé l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. C’est des sujets qui font des étincelles et pourtant c’est des livres qu’on étudie en classe. Il y a des profs, des CDI qui les font connaître à l’école. Et je suis reconnaissant que ces livres soient étudiés parce que ce n’est pas très simple, parce que ça vous confronte à l’histoire coloniale, à la répression, au regard sur l’autre. Quand vous regardez quelqu’un devant vous comme un autre et non plus comme votre semblable, il y a problème. Les hommes devraient regarder les autres hommes en disant : « C’est mon semblable. » Et pourtant d’habitude on dit : « C’est un autre, il est différent. »
Mais je crois qu’à l’école il faut en parler. Il faut pas imposer une idée mais aborder tous ces problèmes-là. Dans une société un peu malade, c’est important de parler de tout cela. C’est pas facile mais c’est une nécessité.
Noémie : Avez-vous des amis Kanaks ?
D.D. : Oui, il y en a un que j’ai mis dans le deuxième roman sur la Nouvelle-Calédonie, Le Retour d’Ataï, il s’appelle Jimmy. C’est un copain qui vivait à Paris et qui est reparti vivre là-bas. Dès qu’il y avait une manifestation, pour droit au logement, pour ceci, pour cela, il était là, Jimmy. Il est reparti avec sa femme, il est marié avec une Française. En Nouvelle-Calédonie j’ai lié de nombreux contacts.
Jonathan: Quel est votre auteur préféré ?
D.D. : Il y en a beaucoup mais il y en a un que je cite toujours parce qu’il est symbolique. C’est quelqu’un qui a écrit sur les bas-fonds de Londres, sur la ruée vers l’or, sur les chercheurs d’or, sur le Grand Nord, les animaux… Il a écrit aussi de petits textes, des nouvelles. Il y en a une qui fait cinq ou six pages qui s’appelle Construire un feu. Jack London a écrit aussi L’Appel de la forêt, Croc blanc…Il est souvent considéré comme un romancier pour les jeunes, ce qui est complètement fou. C’est un type qui s’est suicidé à quarante ans et il a écrit une soixantaine de bouquins sur les bateaux ou la Nouvelle-Calédonie. Il s’est baladé en bateau là-bas vers les îles Fidji. Il a fait plein de textes d’aventures maritimes.
Pour Construire un feu, c’est l’histoire d’un type dans le Grand Nord. Il y a de la neige partout et il faut absolument qu’il fasse un feu sinon il va mourir, il est avec son chien. Il n’y a rien à comprendre, c’est des émotions que vous êtes en train de vivre avec le personnage qui a les doigts gelés, le froid lui a déjà bouffé les panards. Et vous êtes là, vous êtes en train de lire et vous l’aidez. Et il y a le chien qui est là et vous l’aidez aussi parce qu’ils vont crever tous les deux. Il n’y a rien à comprendre. Vous lisez et vous êtes avec eux. Il faut tomber sur les bons bouquins qui vont vous parler comme ça. Le bouquin qui peut vous parler, il ne parlera pas à l’autre. Donc, c’est à chacun de faire son marché.
Douglas : Mais on peut aimer qu’une seule sorte de livres. Moi j’aime que la science-fiction, le reste j’y comprends rien.
D.D. : Oui, moi aussi, à une époque je ne lisais que de la science-fiction, maintenant je n’en lis pas. Peut-être que dans deux ans tu aimeras les romans policiers, les récits de voyage. Tu n’en sais rien. Vous savez lire, c’est le principal.
Jeremy : A notre âge, aimiez-vous l’école ?
D.D. : Vous êtes en troisième… j’ai eu un grand traumatisme à l’école. Mon directeur voulait que je devienne instituteur et, à l’époque, pour devenir instituteur, il fallait aller en internat et pour moi c’était un traumatisme absolu donc j’ai tout fait pour devenir mauvais élève.
Propos recueillis par la professeur de lettres-histoire, Anne Vescovi
& par la documentaliste, Priscilla Mommessin.
Merci à Corinne Pesquier pour la captation vidéo et à Louis Desplat pour l’enregistrement audio ainsi qu’à toute la classe de 3T promotion 2002-2003 avec une mention spéciale à Douglas Da Sylva Rangel pour son enthousiasme. Et merci surtout à Didier Daeninckx de s’être prêté avec simplicité et justesse à ce questionnaire.